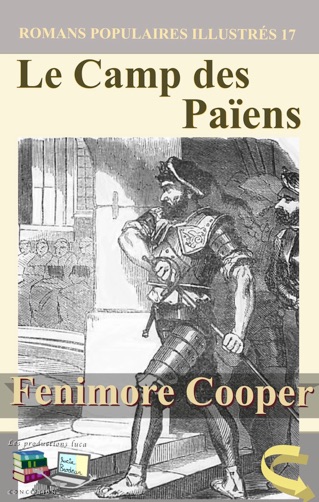Visiter l’ermite
À cette époque, où les esclaves des passions les plus grossières croyaient les expier par des actes d'abnégation physique, on voyait souvent des hommes fuir les séductions du monde pour s'adonner à la pénitence et à la prière dans des grottes ou des cabanes isolées.
Cette prétention extraordinaire à la piété était souvent le masque de l'ambition et de la fourberie. Mais il faut avouer qu'elle provenait en général d'un zèle sincère, quoique mal dirigé. Les ermitages sont encore assez communs dans le sud de l’Europe. Ils sont rares en Allemagne aujourd'hui.
Mais, avant la réforme du seizième siècle, on les trouvait peut être plus fréquemment au Nord qu'au Midi. C’est une loi de la nature, que les impressions sont d'autant moins durables qu'elles sont facilement reçues, et il y a peut-être dans le caractère des races septentrionales plus d'aptitude que dans celui des Italiens aux mortifications de la vie ascétique.
La constance et la sévérité nécessaires pour les endurer se rencontrent moins aisément chez les heureux et légers enfants du soleil que parmi les habitants des régions du froid et des tempêtes.
Sans examiner les principes de ceux qui abandonnaient les joies mondaines pour l'amour de Dieu, on peut dire que leur genre de vie n'était pas sans charmes pour les esprits malades, surtout lorsque l'ambition n'y était pas absolument éteinte. Rarement un ermite cherchait une solitude complète. Il s'installait à peu de distance d’une population simple et pieuse, dont il se conciliait les respects et la soumission.
Celui que l'on appelait à Duerckheim l'anachorète des Cèdres, bien qu'établi depuis six mois seulement, exerçait déjà une grande influence dans la contrée. D'où venait-il ? Combien de temps comptait-il rester là ? Quelle avait été sa vie antérieure ? C'est ce que tout le monde ignorait. On ne l'avait pas vu arriver.
Personne ne pouvait dire d'où il avait tiré le chétif mobilier de sa cabane. On l’y trouva un jour installé, après avoir réparé le toit d'une des maisons désertes, de manière à se garantir des tempêtes. Pour indiquer les motifs de sa retraite, il lui avait suffi de planter un crucifix.
L'établissement d'un ermite dans un canton était d'ordinaire accueilli comme un événement de bon augure, et quinze jours après l'arrivée de l'anachorète des Cèdres, bien des gens se promettaient d'avoir recours à ses prières pour réussir dans leurs entreprises temporelles.
Les bourgmestres de Duenkheim, le comte Emich et les moines furent les seuls mécontents que fit la présence de ce vénérable personnage. Le baron hautain tenait de ses ancêtres un préjugé invétéré contre les dévots, parce que le couvent voisin disputait depuis des siècles à sa famille la souveraineté de la vallée. De leur côté, les magistrats jalousaient toute action morale en dehors des lois civiles.
Quant aux moines de Limbourg, ils ne virent pas sans un secret dépit un homme dont la sainteté pouvait être irréprochable, mais qui leur faisait concurrence. Jusqu'alors l'abbé avait été juge en dernier ressort de toutes les causes spirituelles. Et comme sa suprématie avait la sanction du temps, il en avait joui avec cette insouciante sécurité qui trompe les heureux du monde, même quand ils sont près de leur chute.
L'antipathie de toutes les puissances du pays aurait pu être funeste à l'ermite si elle n'avait été neutralisée par l'opinion. Les croyances populaires protégeaient l'humble cabane, et pendant plusieurs mois l'étranger ne reçut de la masse du peuple que des témoignages d'estime et de respect.
Le hasard l'avait mis en rapport avec Berchtold, et comme on le verra dans le cours de cette histoire, il y avait encore d'autres personnes auxquelles ses prières et ses conseils n'étaient pas indifférents. Les trois individus qui se présentaient au seuil de la cabane eurent de ce fait une preuve convaincante.
L’anachorète n’était pas seul. Leurs pas avaient été entendus, et une femme agenouillée eut le temps de se relever et de rabattre sa mante sur son visage. Au moment où elle s'enveloppait à la hâte, le bénédictin entra, suivi de Berchtold et du vacher, qui regardaient par dessus ses épaules avec une curiosité mêlée de surprise.
L'ermite était un homme d'un âge mûr. Ses yeux n'avaient rien perdu de leur intelligente vivacité. Mais ses mouvements avaient la lenteur et la réserve qu'une longue expérience leur donne insensiblement lorsqu'on n'a pas vécu en vain.
Il ne parut nullement étonné de cette visite imprévue. Mais, après avoir fixement contemplé ses hôtes, il les invita à entrer par un geste plein de douceur. Le moine obéit en jetant un regard de soupçon et de jalousie sur le saint homme.
— Je ne savais pas, dit-il, que tu étais investi par l'Église du droit d'écouter la confession des fidèles, et de les absoudre de leurs péchés.
— Ce dernier droit, mon frère, n'appartient qu’à Dieu. Et si le chef de l'Église le possède, c'est uniquement comme humble instrument de la foi.
Cette réponse ne désarma pas le moine, qui essaya inutilement de reconnaître la femme dont la présence l'étonnait. Celle-ci s’était mise à l'écart autant que pouvait le permettre la petitesse du local.
— Tu n'as pas même la tonsure, reprit brusquement, le bénédictin.
— Tu le vois, mon père, j'ai tous les cheveux que le temps et les infirmités m'ont laissés. Mais croit-on, dans ta riche abbaye, que les avis d'un homme assez vieux pour connaître et déplorer ses fautes puissent nuire à l'inexpérience de la jeunesse ? Si je suis dans l’erreur, tu viens encore à propos pour me désabuser.
— Que cette jeune fille vienne au confessionnal de l’abbaye. C’est là qu'elle trouvera des consolations.
— J'en suis garant, interrompit brusquement le vacher incapable de rester muet plus longtemps. Ma bonne mère m'a souvent recommandé d'aller confier mes peines au révérend père de l'abbaye, et surtout au père Siegfried, qui l'emporte sur tous par ses vertus.
— Qui es-tu ? demanda le bénédictin. Pourquoi te permets-tu de m'adresser en face des éloges que je mérite si peu ?
— Je voudrais être le comte Emich de Hartenbourg, ou même l'électeur palatin, pour rendre ample justice au religieux que j'honore.
Qui je suis, mon frère ? Est-il possible que vous ayez oublié une figure qu'on voit si souvent au confessionnal ? Les qualités que je possède, père Siegfried, c'est à toi qu'elles sont dues. Mais il n'est pas étonnant que tu n'aies pas conservé mon souvenir, puisque l'humilité commande aux chrétiens d'oublier leurs bonnes oeuvres.
— Tu t'appelles Gottlob. Mais c'est un nom assez commun.
— Beaucoup le portent, révérend moine, mais peu lui font honneur. Gottlob Frinck est le plus grand vaurien de Duerckheim. Gottlob Popp pouvait avoir plus de respect pour les voeux qu'on a prononcés en son nom au baptême. Quant à Gottlob de Manheim...
— Laissons de côté les égarements de tes homonymes, en faveur du bien que tu as pu faire, interrompit le bénédictin, viens à moi toutes les fois que tu le voudras, mon fils, et je ne te refuserai pas les conseils que peut donner un esprit faible quand il est fortifié par la pureté des intentions... Mais que sont devenus la jeune fille et ton compagnon ?
Ayant joué son rôle avec succès, le vacher se mit à l'écart en feignant un étonnement naïf.
— Tes hôtes sont partis ? reprit le moine en s'adressant au solitaire.
— Ils se sont retirés volontairement, comme ils étaient venus.
—Tu as souvent occasion de les voir, saint ermite ?
— Mon frère, je ne questionne personne. Si l'électeur Frédéric venait chez moi, il serait le bienvenu, et ce vacher ne l'est pas moins. À tous deux, à leur départ, je dis : Dieu vous conduise !
— Tu gardes les bestiaux des bourgeois, Gottlob ?
— Révérend moine, je garde les troupeaux que mes maîtres veulent bien confier à mes soins.
— Nous avons de graves sujets de plainte contre un de tes collègues qui sert le comte de Hartenbourg, et qui envahit tous les jours les pâtures de l'église. Connais-tu ce drôle ?
— Ah si tous les coquins qui commettent en cachette une pareille infraction étaient rangés devant l'abbé de Limbourg, il serait bien embarrassé de les punir ou de prier pour eux. Moi-même, que ma mauvaise fortune force à vivre au milieu de tels compagnons, il m’arrive souvent de douter de ma propre conduite.
Le bénédictin contempla d'un air de défiance l'humble physionomie de Gottlob. Il lui fit ensuite signe de se retirer, et s’occupa du véritable but de sa visite à l'ermitage. Il serait prématuré d’en dire actuellement le sujet. Il suffit d'indiquer qu'elle était relative aux dissensions de l'abbaye et du château.
Le moine se retira après une demi-heure de conférence, et à sa grande surprise, il retrouva près de la porte Gottlob, que des raisons particulières avaient décidé à attendre.
— Toi ici, mon fils ! s'écria le bénédictin. Je te croyais dans ton lit, dit-il, heureux d'avoir reçu la bénédiction du saint ermite.
— Une si bonne, fortune est faite pour chasser le sommeil de mes yeux, répondit Gottlob en marchant à côté du moine, qui se dirigeait vers l'ancienne porte du camp. Je ne suis pas de ces animaux qui ne songent qu'à dormir quand ils sont bien repus. Mais plus je suis satisfait, plus je me dens éveillé pour jouir de mon bonheur.
— C'est une intention que l'on ne peut blâmer. Mais, dis-moi, ajouta le moine en se rapprochant, puisque tu es de Duerckheim, peux-tu me faire connaître l'opinion du peuple dans la querelle de notre vénérable abbé et de messire Emich de Hartenbourg ?
— À parler franchement, révérend père, les bourgeois voudraient voir cette affaire réglée et savoir à quoi s'en tenir, car ils trouvent pénible de servir deux maîtres à la fois.
— Mais, enfin, que pensent-ils des religieux et du comte Emich ?
— Ils regardent les moines comme des hommes de Dieu, et le comte comme un vaillant chevalier. Mais ils ne se permettent pas de décider entre les deux parties, sachant combien l'homme est fragile et sujet à l’erreur.
— Pour un vacher, tu ne manques pas d'esprit, sais-tu bien ?
— Grâce à Dieu, la Providence a mis un peu d'instruction sur mon chemin, et je me suis hâté de la ramasser.
— C'est un don plus nuisible qu'utile à un homme de ta profession. À quoi te sert-il pour conduire tes troupeaux ?
— À la vérité, mes vaches ne s'en trouvent pas mieux, vénérable moine. Pourtant il est des cas où elles en profitent.
— Quel conte invraisemblable ! il y en a de pareils en circulation depuis la funeste découverte de Gutenberg de Mayence. Mais comment peux-tu croire que la lecture soit utile à des bêtes ?
— Patience, père Siegfried, et je vais te prouver ce que j'ai avancé. Suppose deux serviteurs de messire Emich. L’un sait lire, l’autre ne le sait pas. Le premier, ayant lu la description des limites qui séparent les terres du couvent et celles de sa seigneurie, sait où trouver les bons pâturages. Le second, par ignorance, gravit tout simplement les coteaux qui appartiennent au comte.
— Le savoir n'a guère éclairci tes idées, Gottlob, malgré l’adresse que tu mets dans tes réponses... Ainsi tu crois que les bourgeois de Duerckheim observeront la neutralité ?
— Mon père, si tu veux me dire de quel côté sera la victoire, je serai à même d'indiquer d'une manière précise le parti que les bourgeois soutiendront de leur épée. Ce sont des hommes prudents, qui se battent rarement contre leur intérêt..
— Comment savoir lequel l’emportera ? Cependant l'homme le plus favorisé dans cette vie finit souvent par succomber, et celui qui souffre dans la chair recueille des avantages spirituels.
— En ce cas, s'écria Gottlob d'un air ingénu, le saint abbé de Limbourg pourrait bien avoir un jour une condition plus triste que celle d'un paysan. On assure qu'il ne néglige pas les besoins du corps, et qu'il sait distinguer le vin du Rhin des liqueurs insipides qui viennent de l'autre côté de nos montagnes. Le paysan, au contraire, moins par goût que par nécessité, ne se désaltère qu'avec l'eau des fontaines.
— Tu n'es pas sans intelligence, reprit le bénédictin. Je l'ai déjà remarqué dans tes visites à l'abbaye, et tu devrais songer à mettre ton esprit naturel au service de l'Église.,
— Il est vrai, vénérable bénédictin, que je suis le plus habile vacher de toute la contrée.
— Aussi, reprit le moine, nous ne serions pas éloignés de te confier la garde de nos nombreux troupeaux. Mais il faudrait mériter, par un service signalé, la faveur de saint Benoît et de ses enfants. Nous avons des raisons pour supposer qu'il y a au château une troupe d'hommes avinés prête à nous attaquer, dans le fol espoir qu'un riche butin serait le prix du sacrilège.
Nous voudrions avoir des renseignements circonstanciés sur le nombre des hommes d'armes et les intentions du comte. En employant à cette mission un homme connu, nous nous trahirions inévitablement. Mais un serviteur comme toi n’inspirera point de soupçons.
— Fort bien. Mais si le comte Emich apprend l’affaire, il ne me laissera pas une oreille pour écouter vos saintes exhortations.
— Il ne se doutera de rien. Est-ce que tu n'as pas cent prétextes pour entrer dans le château ?
— J'en ai mille. Je puis demander à parler au vétérinaire, ou solliciter un changement d'emploi, ou feindre d'être attiré par les doux yeux de quelque jeune fille.
— Il suffit. Tu es l'homme que je cherche depuis quinze jours. Poursuis donc ton chemin, et viens me trouver demain après la messe.
— Cette démarche me vaudra le ciel, sans doute, repartit Gottlob, mais il faut songer aussi aux choses d'ici-bas. Dois-je risquer mes oreilles, me compromettre, et négliger mon troupeau sans motif ?
— Tu serviras l’Église, mon fils. Tu t'assureras les bonnes grâces de notre abbé, et tu auras ta part dans les prochaines indulgences.
— Je sais bien que je servirai l’Église, digne bénédictin, et c'est un privilège dont un vacher peut être fier. Mais en servant l'Église, je me ferai des ennemis sur la terre. D’abord, parce que l'abbaye n’est pas très honorée dans ce vallon. Secondement, parce qu'on porté envie aux hommes qui valent mieux que les autres.
Gottlob, me disait souvent mon père, si tu veux vivre en paix avec tes semblables, affecte d’avoir conscience de ton indignité. Mais, ajoutait-il, pour obtenir leurs respects, mets un haut prix à ce que tu feras. Le monde ne te saurait pas gré de ton désintéressement, et si tu travailles pour rien, il croirait que tu ne mérites rien. On estime peu ce que l'on acquiert aisément, et l'on dent pour précieux ce qui coûte beaucoup.
— Tu es comme ton père, tu ne perds jamais de vue tes intérêts. Mais tu sais que nous autres habitants des cloîtres, nous n'avons pas d'argent sur nous.
— Si c'était de l'or, équitable bénédictin, je ne romprais pas le marché pour cette misère.
— Eh bien ! tu en auras, sur la foi de ma sainte profession. Je te donnerai l'effigie en or de l'empereur si tu parviens à te procurer les renseignements que nous te demandons.
Gottlob s’arrêta, et s'agenouilla devant le moine pour lui demander sa bénédiction. Ce dernier la lui donna, et avant de le quitter il se demanda s’il était à propos d'employer un émissaire dont l’astuce égalait la simplicité. Comme il ne courait aucun risque, sauf celui de recevoir des details peu exacts, il ne crut pas devoir décommander la commission.
Nos deux conspirateurs descendirent ensemble la montagne en s’entretenant de l'affaire dont Gottlob était chargé. Ils se séparèrent lorsqu’ils furent assez près de la route pour craindre d'être observés.